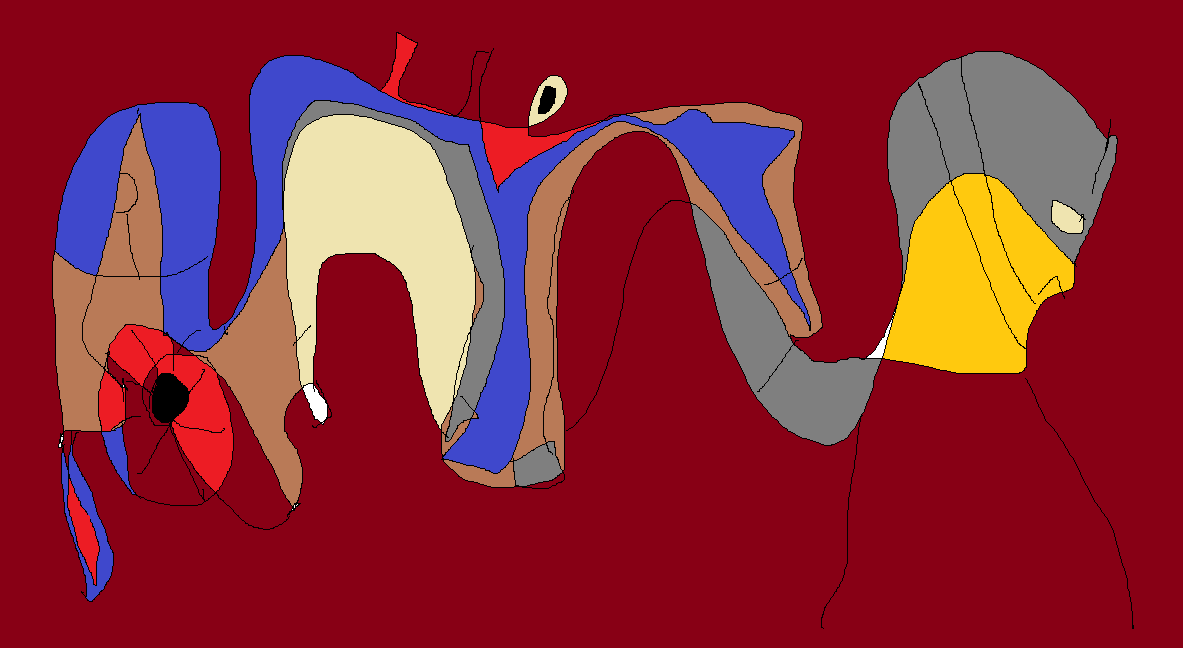février
mercredi 1er mars 2017, par
3.2.17
Les mots ont une fissure, la trouver.
La fissure a un corps, désincarcérer.
Et le corps alors ? Sécréter, faire couler des secrets.
Les mots sont des mouches, leurs yeux à facettes multiples des miroirs à mille entrées.
Il y a des insectes dont les ailes parlent et d’autres dont le silence menace. Il y a des mots qui ronflent et d’autres qui expirent un peu d’âme, un peu de sang, un rien qui rampe hors de soi et colonise le ciel.
Espionne la divagation des matières, celles qui bruissent et le silence surtout qu’il y a derrière et qui est de l’eau encore, qui est une mer encore et qui va à l’averse.
Plus les mots sont mystérieux, plus ils sont voyants et si tu veux dire mets-toi à la salive, là où se lient l’essence et le dessous.
4.2.17
Parler couramment le silence, apprentissage de soudeur.
Mettre une ligne de flammes aux lèvres, aspirer jusqu’au mégot le dire.
Laisser fondre le sceau, contrat entre soi- la soif et soi- la révolte.
Ensuite, reprendre son vocabulaire, Wörterbuch, chaque mot dans sa traduction multi-sens, le pluriel aussi et son accord lancinant avec les règles vernaculaires de la bouche.
Le silence est une langue vivante avec des déclinaisons éternelles, et ce neutre qui convient aux affaires propres.
Le silence est un patrimoine de l’humanité.
Se taisent les cailloux, les purs et les fœtus.
Se taisent les anciens tandis qu’hurlent autour les ineptes bradeurs du son
Tandis que je gomme le bruit par zones blanches pour une issue mélodique du moindre vacarme
Et je balbutie comme une élève mauvaise les devoirs du mutisme.
5.2.17
J’ai ce goût des choses vives, les pierres surtout, ces points de suspension posés sur le chemin. Et le bruit dans la bouche de ce qui dure, que le temps n’entame qu’à la lime patiente des aubes.
J’ai ce goût des beautés sans air, des âmes planes des matières éternelles, et ce mur qu’elles sont, propices à jeter des ondes dans l’aveugle. Dans ma main, elles répètent sans cesse, la même mesure du chant. La langue des objets.
6.2.17
Jour après jour se réparer
De colle, de plâtre, de quelques mots
Parer au temps qui démonte, du verbe de la colère,
Avec des bouts de ficelle éternelle et le mastic des histoires
Jour après jour se reprendre, s’ajuster à la maigreur à venir, économiser l’imprécis, consolider l’absence.
Se vérifier, c’est-à-dire tendre à son véritable
Se parer justement
Et mobilier retapé, se laisser au moindre souffle, gamine qui joue avec l’ombre de l’été
Ils disent : cessez de nous faire perdre notre temps taisez-vous qu’on se préoccupe
Et vous avec le fourbi des rétameurs
Vous vous jetez hors du poème
Enfin ! Vous soupirez
Enfin ! Ils vous vomissent.
9.2.17
Il y a des saisons où les matins n’existent pas encore. Ils sont absents des fenêtres, derrière la Terre.
Longtemps il est nécessaire alors de tourner la manivelle, remonter l’obscurité à la force : parler aux arbres, à l’herbe au pays doucement doucement et apprivoiser les choses éteintes.
Dresser la tente du vivre comme une acrobate aux soucoupes, faire tourner l’univers. Qui a failli se briser à ses pieds.
D’ailleurs il se brise parfois.
Une seule assiette de Saturne suffit à casser la lumière
Et on attend que la colle prenne entre le pouce et le doigt.
10.2.17
Nous n’avons pas les mêmes voyelles. Les nôtres résonnent dans l’arrière-fond de la bouche. Ce sont des couleurs altérées parce que le rêve serait de ne jamais les vendre. Nous avons de ces sons autres, sarclés sous la dent et dans l’absence de dent, le trou dans la gueule. La voix est une chienne têtue qui refuse d’avancer, résistant à la cage. Aucun vaccin pour l’adoucir et l’endormir, actes derniers.
Nous n’avons pas les mêmes consonnes, les nôtres se hissent, étripent les joues et « s’éclaffent » contre la viande. On les catapulte à l’orée, on les sulfate. On attend que ça caillasse la parole, que ça innerve, que ça mastique. On attend le relief et que là-bas on doive épouiller nos mots de leurs aspérités et de leurs dépressions.
Nous reste en commun la ponctuation, le point surtout et la suspension comme un fil de poudre sur le chemin des barils. Ensuite on bourre nos dires dans un pavé, on justifie aux quatre coins. On dit voici le béton de notre âme. Et il tombe lourdement au pied de l’argile du monde.
11.2.17.
Nous, l’ombre et le squelette, avons d’un corps commun pris l’instable pour un banc de nuages. Nous avons posé là-haut les yeux et survécu à l’épreuve des fruits mûrs.
Nous l’ombre à terre et l’épieu, avons retenti suspendus ensemble dans le temps la hache et son bruit
Nous à l’étrange silhouette des hommes, avons couru ventre et terre dans les dimensions de la pluie, cette belle faiblesse des choses.
Nous qu’on dit si différents si peu si rien, nous avons été, de saisons en saisons, tour à tour debout et mort, des revenants.
Nous qu’un autre que nous prononce en allumant la flamme, nous sommes, la main tendue, le bras levé, de la reddition des souffles, un seul, simple nous.
Perdus douloureux, des jeux battus d’avance.
12.2.17
Je suis attendue dans l’herbe des abeilles. Ce sera un jour de l’été.
Dans l’ombre de l’arbre, hospice minuscule des fanes et des regrets
J’userai du soleil pour nouer mes attaches.
Je porterai la robe fourreau des souvenirs, mon filet et ces mailles de larmes
Je vous quitterai en douleurs, c’est le pacte que l’on fait en aimant
On se donne la mort pour le prix de l’amour
Pour le savoir, il n’y a qu’elle et le temps aussi
Car l’éternité n’aime rien et se contente.
Et si je meurs heureuse ce ne sera que de vous pleurer, vous mes racines dans le vivre
Mon ruban et le lien
13.2.17
J’ai un œil d’éléphant sous le coude
Labyrinthe des usures et de mémoire
Mon bras regarde et se souvient.
J’ai des gestes à rebours de sens
Il faut bien tromper le temps pour d’autres battements de cils
J’en ai même deux, à l’amont des défenses.
– On me tuera peut-être d’avoir montré mes dents-
Des ivoires gravés de veines, précieux porte-faix, des ivoires de felouque sur le Nil avec des charges de soleil aux gencives
J’ai un regard pachyderme
Là où se ploient mes os, serrés
Deux yeux pendus le long du souffle, battants inutiles
Ils engrangent le souvenir
Pour un feu de savane.
14.2.17
Nous n’allons rien connaître
Les pans de l’univers sont cousus d’agrafes.
Rien ne va sortir d’entre nos draps ni l’enfant ni le cri
Nous sommes des gens à l’ancre des fumées, deux bouches blanches
Et l’amour comme un félin qui franchit le feu
Nous n’allons rien savoir
Nous resterons à la surface close des portes, le ciel de verre des gens qui supposent, le bleu éteint des choses
Nous resterons chacun et la fin des souvenirs
Jamais nous ne fûmes des personnes du pluriel
C’est ainsi que rien n’existe
Ni je ni tu
Dans les combines des jours.
La première nuit est celle qui ouvre la porte. La nuit qui ouvre tes noces d’amour ourle tes noces de mort. S’enfonce en vos chairs la graine de finitude. Tu le sais, c’est dans le plus lointain du temps que tu attaches alors ta barque. Tu iras t’accrochant et te his-sant le long de la disparition parce que tout ce que tu es doit finir et tout ce qu’il est aussi. L’amour met en toi la semence de mort car sans elle, sans cette compagne, tu n’aimeras jamais dans ta chair. Or seul ton corps est capable de toucher pour toi l’éternité des Dieux et l’attache céleste qui te fait sien-ne amour dans l’amour. Et sans cette certitude que rien de toi ni de lui-d’elle ne va durer, sans cette tristesse, ce mal de vivre, tu ne sauras jamais l’étendue ininterrompue de l’amour.
Eden, l’aseptique paradis des gens éternels, a mis la mort entre nos mains car nous n’aurions sans elle jamais connu l’intensité de ce qu’est la vie. C’est l’arbre ramifié des mille morts dont voici le fruit. Mange-le et tu aimeras et tu approcheras le feu d’amour. Refuse-le et tu dureras, une pierre.
15.2.17
Maintenant je tombe de haut, le ciel dégaine la cage des moineaux. L’aube secoue l’amour à la fenêtre.
J’attache l’ombre à mon arbre, comme un gage de retour à la nuit. C’est tout ce qui me reste.
J’attendrai sagement domestique et fidèle que le soleil te charrie dans ce fleuve trop bleu et t’épuise
Et puis tu glisseras par les coursives, comme un maitre d’ivresses trancher mes servitudes, pour me jeter le bois du jour.
Je te ramènerai le jouir et l’hypnose jusqu’à ce trop d’étoiles.
Tu dormiras dans mon silence
Et je tomberai, à nouveau.
16.2.17
Après la nuit
Alors on rentre et l’intérieur est vide
De soi personne, ni le mur ni le liseron
Que l’ombre du chat sur laquelle on jette ses sept mémoires, pelisse insolite
Zébrée de ruts et de turbines
Nous avions dormi pour goûter notre mort
Un essai de raideur, son mutisme de cadavre
Nous étions descendus dans les urnes de cendres
Camisoles de poussières et du feu
Pour comprendre l’avenir et l’enfer
Aller aller à la particule
L’éclosion du nuage
Et revenant d’avoir été atome
L’immensité nous annule
17.2.17
C’est un matin de torchis, de cheveux où l’intérieur se tait
Cousu de laque et de plâtre
Toquer au mur le gratter le frapper. Il résonne aussi creux que l’amphore de la soif.
Un matin de violence. Je pousse mon être dans les coins de la chambre, j’espace pour le dérisoire qui réclame des soins de tyran
Tamiser la farine du vent
Faire une fontaine pour la mesure de pluie
Casser l’oiseau avant le vol
Battre masser le pétrin
Mettre sa vie à brûler
Attendre la prochaine saison
Pour consommer le quotidien
18.2.17
C’est le chant du porteur de terre, le monde balance dans son dos, un peu de vie et les anciennes morts.
Un sac et l’épaule sciée de crins et de chanvre, laudate laudate
C’est ce mouvement de son corps qui métronome le pas.
Et il avance ainsi charriant la pesanteur des plages, l’infinitude des déserts et les récoltes
Il traîne le feu des savanes, les langues d’ombres, les retours chaque soir des portes de la nuit
Là où la terre se confond avec le ciel et d’un même charbon
Il range alors l’univers dans sa poche, puisque le rêve est immense, une graine où tout se résume et se tient.
19.2.17
Déjà la nuit, petit bois jeté dans l’aurore qui brûle
Déjà ciel rincé, une faïence pour le thé du matin
Déjà la broderie des oiseaux, le peigne du vent dans le bouleau
Et mon retard qui court au cerceau, la terre entière au bout de son bâton
Je file, la vie devant est en roue libre
Dimanche peut-être
Je laisse la nuit me défaire
Chaque lumière éteinte me démantèle
Je gagne la transparence des espaces sans homme
Mon corps pièce à pièce se démet des apparences
Et ta main lointaine me traverse
Et ton pas et ton voyage arpentent mon obscurité immense
Je n’ai plus de limites plus de lisières
Qu’une petite robe noire dentelle
Ajustée à la peau de la nuit
Un cache misère sur le puits
Personne ne s’y trempe
À peine de l’encre, à peine du venin
Et touchant de mes deuils les bords du ciel,
Je hisse lâche un hauban d’étoiles
20.2.17
Dans ces phrases il n’y a rien
Qu’un appel d’ancre dans la plage, une halte de ficelle où descendre
Je dois longer mon ombre
En compter les maillons, son élan de lierre à l’assaut des entrailles
Je ne connais la mer que par l’ouïe, mon sang qui bat dans les coquilles
Mais le drap vert qui y dort
Mais la peau des algues sur ma peau
Mais le sel secret dans la main d’une vague
Dans ces phrases je cherche l’océan ou même qui sait une flaque dedans
Où tremper mon étoile
Que cesse le périple des noyades au gré de lune
Que se plantent un orage, une semence ou mon pas
Quelque chose qui amarre
Quitte l’eau l’instable ballant de mes bras
Dans le moulin du temps quelques heures arrêtées
21.2.17
L’automne vient à n’importe quelle heure
Secouer les feuilles de votre visage
Soudain un arbre mort a poussé dans le corps
Frileux collier de cascades et truites de sel
Une saison en nombres entasse votre histoire
L’amer silence dont vous êtes cousu
La semence de tavelures
La valise d’aucun départ lestant vos horizons
Vous ne savez encore rien de l’hiver doux
De sa pâleur partout comme au ciel
Vous changez de pelage
Comme un oiseau qui fuit le sort du renard
Et puis le printemps fend le miroir
Une fleur au milieu de votre front
À la cloche suivante
22.2.17
Un fruit bleu grandit à ma fenêtre
Chair luisante
On dit le jour vient
Comme un soleil dans une pelure
Le bleu sans doute est-il la lueur de l’infini, l’espace dénoué des atomes
Ma main aux grosses veines est de lignes de fuite
Chiromancie astronome
Et j’écris ainsi un avenir glacé qui allège ma soif dans un ciel sans pesanteur.
23.3.17
Reprendre le chemin de papier
Marcher sur le craquement des feuilles, biscottes de saison
En saisir le bruit, la plainte des mâchoires, des pépites jetées de l’en-deçà
Les choses mortes parlent encore
Un mot revient, indéchiffrable
Que j’écoute que j’écoute
Dedans un oiseau, un chat, l’ombre de la promenade
Et je passe dans mon imperméable
Juste à côté du secret
Le poème du pas n’entrera pas
Je marche sur la terre
Comme dans la cellule battue
Ma maison de pierre
Et la porte silencieuse.
24.2.17
Dehors, il y a l’attente. L’impatiente.
L’aube, sa veste à franges et cette façon d’enlacer mon pas et de casser ma hanche.
Dehors le jour, l’aguet dans le coin de ma porte. Poison venin, lueurs acides. Je vais entrer dans la teinture de l’absence. Me fondre. Dissoudre. Mon corps passera muscades extorquées, je serai revêtue d’apparences. Les membres, la tête, les cheveux. Prestidigitation.
On me verra telle que déjouée, une épaisseur trompeuse. Dedans il n’y aura personne. Et je viendrai ainsi, ballast creux, de l’aube à la prochaine ombre pour reprendre enfin ma transparence. Nuit dans nuit, ensemble.
25.2.17
La terre tout autour est serrée. Irrespirable. Des statues de vagues dures. Et dedans, partout dans mon corps, se feutre la laine du destin. Je suis ficelée de terroir, lardée de lopins et de haies. Je suis une pierre magnétique pendue dans un crochet de ciel.
Je fends chaque aube le cal de mon souffle, je déminéralise la stèle du jour. Sortir du sarcophage où je mute caillou, déglacer le granit des temps. Je vais ensuite tremper ma tête dans des mots d’océan d’île et de lumière, là où le ciel pénètre le cœur de l’humain. D’une masse au moins atteindre un jour le sable.
26.2.17
La feuille du matin tourbillonne dans ma tête. Un vent de tournevis, un vent dans l’embout de mon crâne. Elle suit ainsi le pas des choses trop légères pour la terre. Elle suit sa rotation d’étoile. Dernière mort avant la lumière. Dernier manège, dernière barque sur la vague invisible.
Un hibou s’éteint emportant dans ses mots le trou de ma mémoire.
Encore un rêve perdu sur la terre comme au ciel.
27.2.17
De combien d’étoiles ai-je déjà défait ma tente ? De combien de pluies ai-je percé les gouttes ? J’ai l’arithmétique repiquée sous les ongles, une histoire de deuils et de lunules noires.
Quand je vois l’aube défroisser sa paupière, la lumière assainir mon cerveau, quand un ciel me balaie la tête, essore mon nuage, je suis les bras contre mes yeux, épouvantée de toujours perdre.
Alors je me résous en de petites choses, la miette de géranium, la mousse sur le fer. Je vais au poquet enterrer le bulbe des tulipes de la nuit, une floraison tardive quelque part dans l’oubli.
28.2.17
Il n’y a pas d’eau qui te parle ce jour. Le ciel est sans histoires, comme un mur sans prières
Aucune saillie, aucune aile pas d’oiseau et pas de souffle. Le ciel a mis son masque de cellophane et je frappe aux grilles sans écho. Je sais que tu ne parles pas tous les jours, qu’il y a des heures de guichet et des heures fermées. Je sais qu’il faut savoir t’attendre avec au ventre cette peur des fins imminentes, des adieux dans la gare où l’on presse contre soi ni l’homme ni son âme mais le temps que l’on voudrait garder, l’image à ses équinoxes de vie. jusque- là j’avançais désormais je recule sur l’estran des rencontres.
Il n’y a pas d’eau qui te parle ce jour, loin le sable, loin la terre.